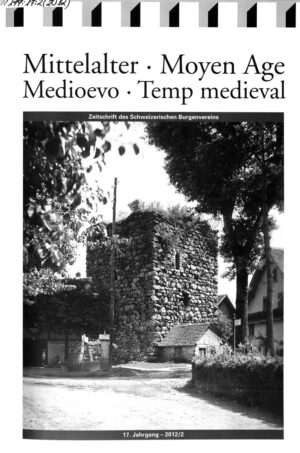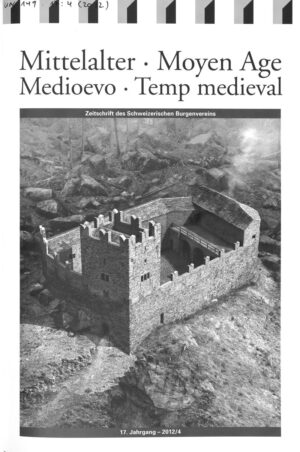Description
Jonathan, Frey: Levez le pont-levis ! Technique de défense de la fin du Moyen Âge dans le canton de Berne, l’exemple des ponts basculants
Christophe, Gerber: Un lot de terres cuites architecturales estampées découvertes à Pontenet, Jura bernois
Lara, Wetzel: Errements et tourments dans la recherche sur le fer à cheval
Elisabeth, Crettaz-Stürzel: Forge et ferrage du mulet au 16e siècle en Valais
Levez le pont-levis ! Technique de défense de la fin du Moyen Âge dans le canton de Berne, l’exemple des ponts basculants
Dans le canton de Berne, 14 exemples de ponts dits basculants sont actuellement connus. Dans ce sous-type de pont-levis, les poutres longitudinales du tablier qui enjambe le fossé sont prolongées au-delà du seuil de la porte et introduites dans le passage pour permettre de suspendre des contrepoids à leur extrémité inférieure. Le poids du pont étant ainsi idéalement
contrebalancé cela permettait à une personne seule de le hisser en un minimum de temps. Pour que la partie des poutres située sous le passage de la porte puisse basculer vers le bas, il devait y avoir des fosses taillées dans la roche ou des puits creusés dans la terre. Les ponts basculants du canton de Berne se concentrent pour la plupart sur les châteaux et les villes du Plateau suisse. La plupart furent construits durant la seconde moitié du XIVe siècle et la première moitié du XVe siècle. Comme d’autres ponts-levis, les ponts basculants servaient de protection supplémentaire pour la porte, qui constituait toujours l’un des principaux points faibles d’une fortification. Si le pont était parfaitement ajusté à l’ouverture de la porte, il était plus difficile pour les assaillants de le tirer vers le bas avec des crochets. De plus, les ponts basculants pouvaient être fermés en quelques secondes et ne nécessitaient qu’un minimum de personnel pour les manoeuvrer. Malgré ces avantages militaires, bon nombre d’entre eux disparurent au cours du XVIe siècle. La présentation des résultats archéologiques
et architecturaux des ponts basculants dans cet article ne constitue qu’une première étape dans l’étude des pontslevis du canton de Berne. Pour une meilleure classification du point de vue de la technique de défense, il faudrait également soumettre les découvertes relatives aux ponts basculants et aux ponts basculants à balanciers et les confronter à un examen des sources écrites et iconographiques.
Un lot de terres cuites architecturales estampées découvertes à Pontenet, Jura bernois
Un ensemble de huit carreaux de terre cuite médiévaux, ornés d’armoiries estampées, est parvenu dans les collections du Musée jurassien d’art et d’histoire. Ils ont été mis au jour entre 1920 et 1966 à Pontenet, dans la vallée de Tavannes (Jura bernois), sur le flanc ouest d’un petit plateau fossoyé de 20 × 24 m, appelé « La Motte ». Une maison forte, dont on sait peu de chose, occupait ce plateau ; entourée d’un fossé, elle disposait peut-être déjà d’un vivier à l’ouest. Les carreaux découverts mesuraient 18,5 cm de côté pour 4 cm d’épaisseur environ ; ils se rapportaient sans doute au sol dallé d’une pièce de réception ; l’absence de mortier sur les faces secondaires suggère une pose sur lit de sable.
Les armoiries estampées sur la face principale des carreaux se rapportent à deux familles distinctes : sept carreaux portent un coq hardi marchant vers la gauche, la patte droite levée, selon une disposition qui varie (rangées successives, diagonales…). Ces armes héraldiques renvoient aux nobles de Tavannes ou à ceux de Malleray, une branche collatérale des premiers ; on retrouve leurs sceaux sur différents documents et chartes. Le second écu est incomplet et son meuble d’armoirie renvoie à la famille noble soleuroise vom Stein, dont une branche devint bourgeoise de la ville de Berne et y occupa des fonctions importantes. D’ailleurs en 1461, un certain Petermann vom Stein, fils d’un ancien avoyé de Berne, épousa en secondes noces Anna von Dachsfelden (de Tavannes) qui détenait une partie de la seigneurie de Douanne.
La forme de l’écu estampé au coq renvoie au 15e siècle, une époque où tant les nobles de Tavannes que ceux de Malleray possédaient des terres et des fiefs à Pontenet et dans les environs. Dès 1410, l’écuyer Renaud de Malleray détient la mairie (Meiertum) de Malleray, cherche à attirer des habitants à Pontenet en les affranchissant de tout impôt. En 1432, c’est Jacques de Tavannes qui détient le fief de Malleray. En 1559, le village de Pontenet se sépare de Malleray ; en 1576, le village ne compte que cinq foyers. Après l’abandon de la maison forte, seul le vivier survécut jusqu’à la fin du 19e siècle au moins.
Quant aux maisons fortes fossoyées, à l’image de celle de Pontenet, elles n’ont pas de vocation défensive, mais sont liées au développement de la petite noblesse foncière qui cherchent à imiter, à une échelle réduite, les édifices fortifiés des seigneurs. Le phénomène est largement diffusé en Europe, mais relativement mal étudié d’un point de vue archéologique en Suisse.
Errements et tourments dans la recherche sur le fer à cheval
La recherche archéologique sur les fers à cheval en Europe centrale en est encore à ses balbutiements. Et ce, bien que la question de la meilleure protection des sabots préoccupe les éleveurs depuis l’Antiquité. Avec l’apparition et l’utilisation d’hipposandales à l’époque romaine et le développement des fers à cheval cloués à partir du Moyen-Âge (les datations antérieures au Xe siècle doivent être examinées avec prudence), l’histoire de la protection des sabots couvre une période de plus de 2000 ans. En raison du fait que les fers à cheval se perdent souvent dans les couches profondes et qu’il n’existe guère de découvertes dans des contextes fiables, l’histoire de la recherche aboutit régulièrement à des propositions de datation qui, si l’on tient compte d’autres sources et d’autres disciplines spécialisées dans le domaine du cheval et du mulet, ne sont plus valables aujourd’hui.
Forge et ferrage du mulet au 16e siècle en Valais
A Vissoie en Val d’Anniviers (all. Eifischtal) VS, les maréchaux-ferrants de mulet (all. Maultier Hufschmied) ont laissés des fresques aux graffitis rouges qui datent du 16e siècle. Ce sont que des restes d’un dessin plus grand et leur état de conservation est problématique. Ils ornent le rez-de-chaussée en pierre crépi d’un grand chalet au croisé des chemins entre Sierre, Zinal, Grimentz et St-Luc (Chandolin). Ce décor peint sur la façade représente une série d’écus armoiries et rosaces, accompagnés d’outils de travail très spécifiques d’un forgeron de mulet (all. Maultier oder im Dialekt Muli, bitte nicht Maulesel übersetzen) et portant les dates 1514, 1580, 1589 et 1592. Une bordure graphique « renaissance paysan » (bäuerliche Renaissanceformen) ferme les graffitis. C’était l’enseigne d’une ancienne forge (all. Werbetafel oder Anzeige). La fresque est un témoin exceptionnel de l’importance des mulets comme bêtes de somme (all. Last- oder Tragtiere) en Anniviers au Moyen-âge. Nous avons identifié chaque outil du maréchal-ferrant à l’aide d’un spécialiste d’aujourd’hui et expliqué la différence entre un mulet et un cheval grâce à notre propre expérience comme propriétaire du mulet « Isidore » à Zinal au début du 21ième siècle. Il est indispensable au futur de différencier dans les fouilles archéologique le fer à mulet et d’un fer à cheval !